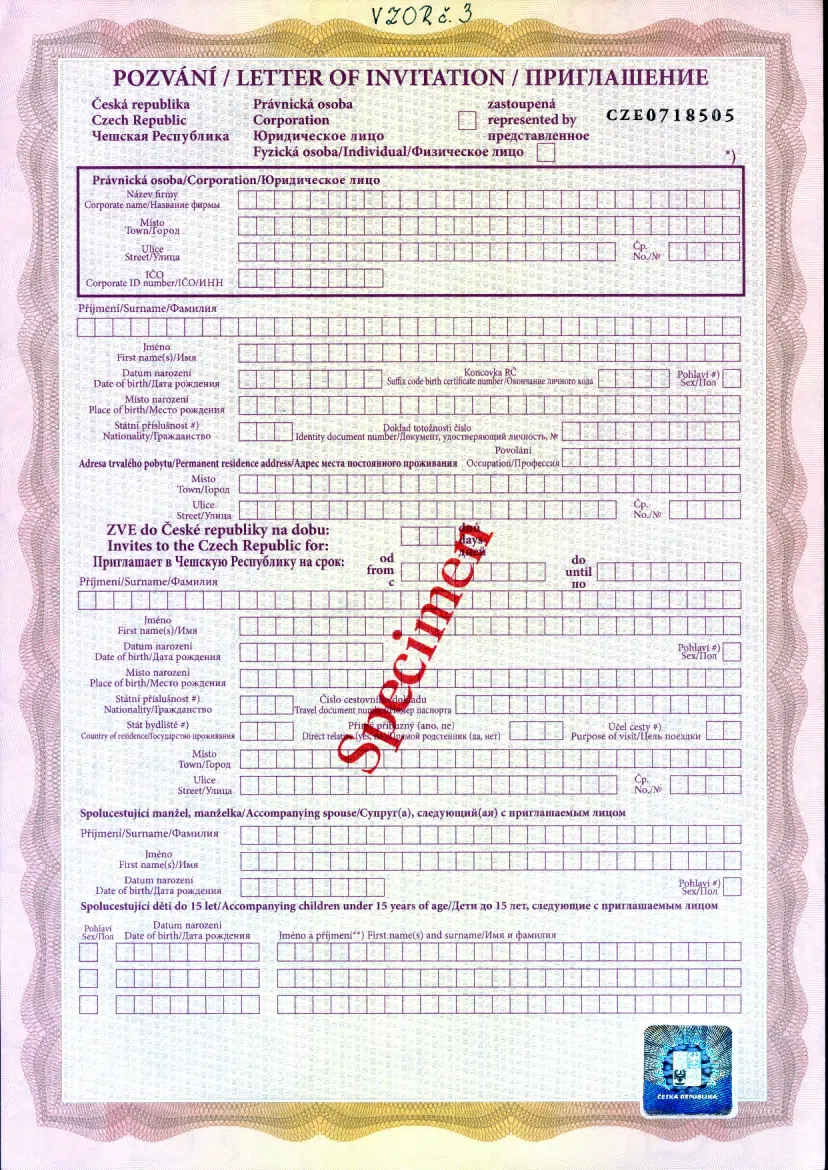Les termes « inclusif » et « ultra-inclusif » ne cessent de s’entrechoquer dans les chartes, les prises de parole, les réunions RH. Pourtant, derrière ces mots jumeaux, un gouffre d’interprétations et d’ambitions. À l’heure où la diversité s’affiche en valeur cardinale, chaque organisation cherche sa propre boussole. D’où vient alors ce flottement ? La réponse se niche dans les pratiques, parfois dans les non-dits, et toujours dans la capacité à transformer la promesse d’ouverture en acte concret.
Inclusif et ultra-inclusif : de quoi parle-t-on vraiment ?
L’adjectif inclusif s’est immiscé dans le vocabulaire courant des entreprises, du secteur public, des associations. Il incarne la volonté de reconnaître la pluralité des identités, des genres, des origines, des situations de handicap. Cette démarche transparaît dans la promotion du langage inclusif, dans la lutte contre le langage sexiste ou encore dans le débat sur la place du masculin et du féminin dans la langue française. On voit émerger des initiatives qui revendiquent, par exemple, l’introduction du genre neutre dans certains usages, ou la redéfinition des tournures grammaticales pour donner davantage de visibilité à toutes et tous.
Mais l’ultra-inclusif, lui, déplace la ligne. Là où l’inclusivité cherche à élargir les frontières d’un modèle existant, l’ultra-inclusivité propose carrément de le refaçonner. L’objectif : faire tomber les barrières structurelles, déconstruire la standardisation et s’attaquer aux normes qui invisibilisent les marges. Regardez du côté de la mode : Sumissura a choisi d’abandonner le concept de taille standard. Fini les compromis, chaque vêtement est conçu sur la base des mesures exactes du client. À la clé ? Une expérience radicalement personnalisée, qui refuse la logique du « toujours plus » pour privilégier le « toujours au plus juste ».
Ce changement de perspective bouscule tout : du design produit à la communication, de l’écriture inclusive à la prise en compte des formes et tailles dans l’offre. L’ultra-inclusivité ne s’arrête pas à la correction d’un biais : elle invite à repenser le processus lui-même, pour garantir une égalité vécue, tangible. Ici, chaque différence, morphologique, identitaire, stylistique, devient une ressource, un moteur d’innovation, et non plus une contrainte à tolérer du bout des lèvres.
Pourquoi la distinction entre ces deux notions suscite-t-elle autant de débats ?
La comparaison inclusif ultra-inclusif ne relève pas d’un simple débat sémantique. Elle touche des enjeux brûlants : égalité hommes-femmes, lutte contre le langage sexiste, choix du genre grammatical dans la langue française. Sur le terrain, ces lignes de fracture traversent les salles de classe, les comités de direction, les équipes de conception. Chacun y défend sa vision, ses priorités, ses valeurs :
- certains militent pour une inclusion accrue des minorités
- d’autres se battent pour préserver l’héritage linguistique
- tandis que d’autres encore revendiquent la liberté d’expression et la possibilité d’adapter les codes à leur réalité
Dans la mode, le clivage est saisissant : la mode rapide impose ses standards, alors que des marques comme Sumissura misent sur la diversité des morphologies et l’expression de l’individualité. Oubliez la taille unique, l’uniformisation : ici, chaque silhouette trouve sa place, chaque client voit ses mesures exactes valorisées, et la production se veut durable, loin des excès industriels.
Le langage n’échappe pas au tiraillement. L’écriture inclusive divise : faut-il s’en tenir à de timides adaptations, ou oser remettre en cause la structure même de la langue française ? Derrière cette interrogation, c’est la capacité de la société à dépasser la conformité qui se joue, pour offrir des réponses sur-mesure, au plus près des attentes individuelles. D’un côté, l’adaptation raisonnable ; de l’autre, la transformation radicale. Entre les deux, une frontière mouvante, parfois inconfortable, qui force à penser autrement.
Tableau comparatif : points communs, différences et implications concrètes
Pour saisir ce qui distingue l’inclusif de l’ultra-inclusif, il faut examiner les pratiques à la loupe. Prenons l’exemple de Sumissura : la personnalisation ne se limite pas à un choix parmi des tailles élargies. Elle s’étend à chaque détail, du tissu à la coupe, du style aux finitions. Le résultat : aucun cadre prédéfini, chaque création est unique, conçue sur la base des mesures exactes du client.
Voici les différences de démarche, concrètes, que l’on retrouve selon les choix d’inclusivité :
- Inclusif : élargit l’accès aux produits ou services à la majorité, en multipliant les options (plus de tailles, plus de modèles), sans remettre en question les standards eux-mêmes.
- Ultra-inclusif : balaie la notion de taille fixe, opte pour une personnalisation infinie et mise sur un artisanat mondial épaulé par la technologie, pour que chaque vêtement colle parfaitement à la personne qui le porte.
| Critère | Inclusif | Ultra-inclusif |
|---|---|---|
| Options de personnalisation | Étendues, mais limitées aux standards | Infinies, totalement sur-mesure |
| Production | Adaptation de la chaîne existante | Production zéro déchet, ajustement pour chaque client |
| Garantie d’ajustement | Confort amélioré | Garantie d’ajustement parfait |
Ce clivage s’observe aussi dans le langage inclusif : l’approche classique ajuste le masculin neutre ou privilégie le pluriel, tandis que l’ultra-inclusif explore le genre neutre, invente de nouveaux usages, bouscule la grammaire. L’exemple de Sumissura illustre ce passage d’une simple adaptation à une dynamique qui donne à chacun les moyens d’exister sans compromis, sans exception tolérée du bout des lèvres.
Comment choisir l’approche la plus adaptée à vos besoins ou à votre contexte ?
La question du choix entre inclusif et ultra-inclusif se joue dans la relation que l’on entretient avec la norme. Dans la mode, Sumissura offre à ses clients la possibilité de créer leur propre style. L’approche inclusive classique élargit l’offre, diversifie les options, mais reste arrimée au système existant. L’ultra-inclusif, lui, rompt avec ce modèle : chaque pièce naît d’un dialogue entre le client et le savoir-faire, pour répondre à la moindre singularité.
Pour vous aider à trancher, voici quelques questions à vous poser selon le contexte :
- Si vous souhaitez mettre en avant l’individualité, l’ultra-inclusivité s’adresse à ceux et celles qui veulent s’affranchir de la standardisation. Chaque vêtement, chaque détail épouse la spécificité de la personne, qu’il s’agisse de morphologie ou de style.
- Si votre objectif est de corriger une inégalité sans bouleverser l’ensemble du système, par exemple, proposer plus de tailles tout en conservant une structure industrielle classique, l’approche inclusive classique constitue une réponse cohérente, compatible avec les réalités du secteur.
Chez Sumissura, la mode se vit comme une expérience personnelle : la confiance se tisse dans le vêtement, l’expression de soi passe avant la conformité. Le même raisonnement s’applique au langage : l’inclusif adapte ce qui existe, l’ultra-inclusif invente de nouveaux possibles, fait du genre neutre un terrain d’expérimentation. Finalement, le choix entre les deux modèles dessine l’avenir : celui d’un collectif qui s’élargit ou d’une société qui s’autorise toutes les singularités. Qui saura tracer sa propre voie ?